Les gilets jaunes : une série en mal de carnavalesque
Le carnaval est un art de renverser le haut et le bas… Le temps d’une fête. Soit un sens de la drôlerie qui manque à la série que nous jouent les gilets jaunes avec leur appel répétitif à la démission de Macron. À défaut, on peut regarder la série Les Tuche montrant une famille ch’ti installée à l’Élysée.
Alors que Notre-Dame de Paris, ce symbole médiéval, religieux et hugolien, a failli disparaître dans les flammes ce 15 avril 2019, les fans de la série Game of thronesdécouvraient le premier épisode de la dernière année de leur série culte. Une série dont la vision médiévale et gothique évoque un univers menacé par des marcheurs blancs, des cohortes de zombies, et par les guerres que se livrent les seigneurs de sept royaumes pour conquérir le Trône de Fer. Quoi qu’il en soit des consonances entre notre époque et le Moyen Âge, l’imaginaire des séries mondialisées ne connaît pas par hasard des succès commerciaux qui dépassent toutes les prévisions, leur imaginaire scénarisé faisant écho aux incertitudes de notre histoire planétaire.
Cette entrée en matière autorise à observer d’un peu plus près « la série française » à succès que représentent « les gilets jaunes ». Voilà un scénario, live et non fictif, dont la recette consiste à réunir des adeptes qui, tous les samedis, se déplacent grâce à des portables qui les mettent en réseau et géolocalisent des itinéraires destinés à tromper des policiers aux allures de Robocop. Reste que cette série répétitive et improvisée, qui n’est pas loin d’atteindre son trentième épisode et reste soutenue – si l’on en croit les sondages – par l’opinion publique, donne l’impression de ne pas pouvoir atteindre une dimension carnavalesque. « La culture populaire “carnavalesque” n’est pas une formule creuse, affirmait à raison Serge Daney, elle se traduit par des formules absolument contradictoires. Soit l’idolâtrie du fan-club, la consommation érotique des icônes, le mimétisme fou, la transe identitaire. Soit une très violente dérision. Exagération infantile, goût du bidon et du truqué… »
Cette culture carnavalesque, qui n’est pas sans lien avec un type d’urbanité qui n’a pas disparu dans certaines villes (villes du nord de la France, villes italiennes comme Sienne ou Florence, villes du Brésil mais pas uniquement celles du carnaval pour touristes, villes du nordeste et d’ailleurs, Barranquilla la capitale du Carnaval en Colombie…), consiste à retourner les places sociales et les assignations culturelles. Elle renverse le haut en bas, elle fait du petit un grand, le prince se déguise pour devenir le serviteur et inversement. Or ce renversement carnavalesque ne fonctionne pas dans le cas de la série réelle à la française. Comme si l’on ne pouvait que couper la tête du roi (« Macron démission… » est un slogan répétitif qui fragilise la série) et ne pas vouloir prendre un masque pour prendre sa place comme tout fou du roi. Cela signifie-t-il que le carnavalesque est le propre des sociétés qui demeurent profondément hiérarchiques, ce que suggère à raison Roberto da Matta dans le cas du Brésil ? Cela est-il lié à l’égalitarisme démocratique où la passion égalitaire empêche que l’on crée des grands théâtres urbains où les « moins que rien » peuvent prendre momentanément la place de ceux qui occupent le pouvoir ?
À ces questions je n’ai pas d’autre réponse que la série des Tuche, une série de trois films, où les scénaristes, avisés et malins, racontent successivement la virée des Tuche, une famille ch’ti du nord, à Monaco, aux États-Unis et à l’Élysée (il fallait y penser !). Dans les premiers films, ils avaient gagné grâce à la loterie de quoi se payer de « fabuleuses et délirantes » virées, mais dans le troisième, le père Tuche s’ennuie tellement dans sa banlieue nordique « version gilet jaune avant l’heure » qu’il décide en famille de se présenter aux élections présidentielles. Vainqueur, il s’installe à l’Élysée où il occupe avant l’heure la place d’Emmanuel Macron. Mais le voilà vite atteint au Château par l’ennui qui confine et la déprime de la représentation publique. Cette série fictive, populaire et carnavalesque à sa manière, racontait sans le savoir une variante de l’histoire des gilets jaunes avant que la série réelle n’apparaisse.
Coup de génie de professionnels de l’imaginaire, ces trois films ont connu un immense succès d’audience auprès de ceux qui devaient devenir les futurs gilets jaunes. Mais, information prise autour de moi, de toutes les plumes pseudo-savantes ou journalistiques qui ont commenté à profusion le mouvement des gilets jaunes, je ne connais quasiment personne qui ait vu l’un ou l’autre de ces films populaires à succès (des millions d’entrées). C’est bien là que réside le décalage entre le haut et le bas, c’est pourquoi les enquêtes montrent que les gilets jaunes n’ont aucun accès (qu’ils le cherchent ou non n’est pas la question) aux institutions culturelles en tous genres (musées, bibliothèques, théâtres…) que la politique culturelle publique met à leur disposition. Pour que le carnavalesque fonctionne, comme c’est le cas dans la remarquable série télévisée de Bruno Dumont Coin-Coin, il faut que les gens du haut fraient avec ou sans masque avec ceux du bas et réciproquement. Autrement, on se retrouve à la télé autour de Cyril Hanouna pour parler en rigolant des gilets jaunes pendant que les élites courent derrière eux pour essayer de les comprendre. Ce qui est regrettable puisque la dimension urbaine de ce phénomène, un carnaval impossible, est indubitable.
Olivier Mongin







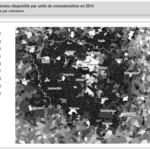
 ar une ONG, ils ont construit un local vaste, équipé de fauteuils en plastique bleu et de tables en bois. Les enfants trouvent là non seulement une aide pour les devoirs mais aussi un endroit où ils ont de l’espace et dans lequel de multiples activités sont organisées pour eux. Du coup, leurs dessins décorent la tôle ondulée des murs intérieurs.
ar une ONG, ils ont construit un local vaste, équipé de fauteuils en plastique bleu et de tables en bois. Les enfants trouvent là non seulement une aide pour les devoirs mais aussi un endroit où ils ont de l’espace et dans lequel de multiples activités sont organisées pour eux. Du coup, leurs dessins décorent la tôle ondulée des murs intérieurs. choses s’améliorent.
choses s’améliorent.

